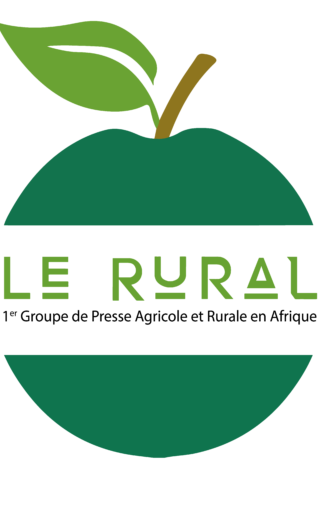L’adoption de certaines pratiques agricoles issues de l’agriculture moderne contribue à la dégradation des sols et impacte négativement les activités agricoles. S’inscrivant ainsi dans la dynamique de restauration des sols, Lidwine BALOITCHA, Experte dans le domaine de l’Environnement propose des solutions comme la technique de Zaï, un excellent moyen pour ramener à la vie les terres africaines dégradées.

Yélian Martine AWELE
La pratique de l’agriculture n’est pas simple dans la région africaine du Sahel. Ce secteur pâtit de la dégradation des terres et de l’irrégularité des précipitations et est souvent soumis à de longues périodes de sécheresse. Pour cette raison, la terre est souvent très compliquée à travailler, si bien qu’il est difficile pour les agriculteurs de planter et de faire prospérer leurs cultures. Toutefois, une nouvelle technologie permet aux agriculteurs de relever les défis environnementaux liés à l’agriculture pour le bien-être de la planète puis d’alléger leur fardeau en contribuant à la remise en état des terres, pour les générations futures : le Zaï. Il est une technique traditionnelle de récupération des terres dégradées (terres encroûtées, tassées, blanchies par la battance, véritables déserts). Lidwine BALOITCHA est Consultante en agro-écologie et gestion durable des terres et adaptation au changement climatique : « La technique de Zaï est une technique qui consiste à faire des cuvettes pour pouvoir recueillir l’eau de ruissellement et mettre au fond des cuvettes, des engrais avant tout semi ». Cette technique dit-elle « permet de restaurer les sols et d’assurer leur fertilisation ». A en croire ses propos, le Zaï consiste à préparer très tôt, en début de saison sèche, une terre dégradée, encroûtée et durcie en creusant à la pioche tous les 80 à 120 cm en quinconce des crevettes de 20 à 40 cm de diamètre (en fonction de l’aridité), de 10 à 20 cm de profondes, en rejetant la terre vers l’aval en croissant pour mieux stocker le ruissellement. La surface non travaillée du champ, qui sert d’impluvium, représente 5 à 10 fois la surface travaillée. Avant les premières pluies, les paysans y enfouissent une ou deux poignées de poudrette (soit 1 à 3 t/ha de déjections animales des parcs exposées au soleil et réduites en poudre par le piétinement du bétail), du fumier, du compost ou, à défaut, des cendres mélangées à des pailles ou des branchettes et des feuilles.