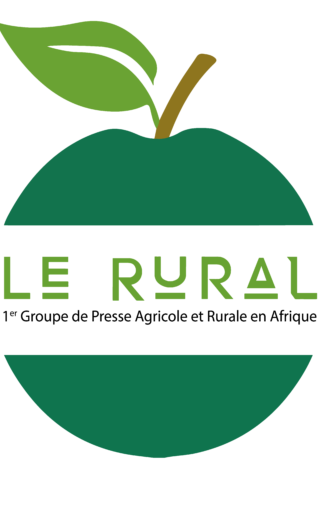TRANSITION VERS L’AGROÉCOLOGIE : Les mesures pour une reconversion réussie
Avec les avancées de l’agriculture, de nos jours, plusieurs agriculteurs, souhaitent adopter des pratiques plus durables et respectueuses de l’environnement. Bien que ce soit une bonne option, puisque la transition vers l’agroécologie est une voie prometteuse, elle nécessite une bonne préparation et un accompagnement adapté.

Madeleine ATODJINOU
Ces dernières années, l’intérêt pour l’agroécologie au niveau des agriculteurs n’a cessé de croître. Nombreux d’entre eux, prenant davantage conscience des enjeux environnementaux et de la santé des consommateurs, se tournent vers des pratiques plus durables. Cependant, cette transition n’est pas sans défis. Des résultats sur le terrain montrent que certains agriculteurs peinent à maintenir leurs rendements lors de la transition vers l’agroécologie. Cette difficulté s’explique par plusieurs aspects tels que : le manque de préparation et de connaissances adéquates au domaine agroécologique, qui est un système complexe demandant de nouvelles compétences et connaissances, puis le manque d’accompagnement technique et financier. Ces défis se retrouvent donc au niveau de chaque échelle d’acteurs. Pour éviter ces écueils et optimiser les rendements, il est essentiel de suivre certaines mesures données.
En effet, selon Firmain Amadji, ingénieur agronome et président du cabinet SolConsult Africa, il est d’abord question de changer de mentalité, tout en évitant la réticence par rapport au domaine agroécologique. Ensuite, il faut prioriser la formation et l’accompagnement.
En outre, il s’agit des formations spécifiques pouvant aider les agriculteurs à acquérir les compétences nécessaires pour mettre en œuvre les pratiques agroécologiques. Un accompagnement personnalisé est également indispensable pour les guider tout au long de la transition. Ce que confirme l’agronome en ces termes : « même si les personnes-ressources importantes, les vrais formateurs en agroécologie ne peuvent pas être sur tous les terrains, lorsque l’on initie des projets, et lorsqu’on donne le marché à des gens pour aller s’exercer à l’agroécologie, qu’on appelle au moins ces personnes-ressources afin qu’ils puissent former le personnel pour une bonne transition vers l’agroécologique ». Il fait savoir également que tous les supports didactiques sont aujourd’hui disponibles, mais restent inutilisés alors que le besoin de former des techniciens de façon cohérente est évident. C’est pour cela qu’avec des démonstrations, toutes les pratiques agroécologiques doivent être toutes démystifiées aux yeux de chaque acteur agricole qui s’y intéresse.
De même, la planification à long terme demeure l’une des principales clés pour une transition vers l’agroécologie et il faut suivre un processus qui prend du temps. Du coup, il est important d’élaborer un plan de transition réaliste et de fixer des objectifs à long terme. Car « On ne vient pas pour faire de l’agroécologie en deux ans, trois ou quatre ans et s’arrêter. Non, la farine ne prend pas encore avec cette courte durée-là, parce que l’agroécologie avec les agriculteurs, suppose la mise en contact de l’innovation, un apprentissage et une appropriation », a-t-il fait savoir.
À cela s’ajoute la pratique de la diversification des cultures. Une rotation des cultures et une association de plantes différentes permettent de renforcer la fertilité des sols, de limiter les maladies et les ravageurs, et d’améliorer la biodiversité, c’est-à-dire des cultures (pois d’angle, le Mucuna, le sorgho, le manioc, etc) qui permettent de minimiser l’utilisation des engrais chimiques.
De même, la valorisation des produits issus de l’agriculture biologique et agroécologique sont de plus en plus recherchés par les consommateurs, et il est important de développer des circuits de distribution courts et de valoriser la qualité de ces produits. Aussi, des politiques agricoles favorables à l’agroécologie sont essentielles pour encourager les agriculteurs à adopter ces pratiques et pour faciliter leur accès à des financements.
Par ailleurs, il faut aussi penser à la protection des champs, en faisant recours à une certaine tradition. Il est donc proposé d’étendre la pratique traditionnelle de clôture des jardins de cases aux champs cultivés. L’objectif dans ce sens est d’utiliser les mêmes espèces végétales (diatropha, isop, etc.), pour protéger les cultures sur de plus grandes surfaces (1 à 2 hectares) contre le pâturage des animaux. Cette mesure est essentielle pour garantir la réussite des pratiques agroécologiques, notamment le paillage permanent du sol.
« Voilà les dispositions obligatoires que doivent prendre les agriculteurs et que lorsqu’ils sont dans les pratiques agroécologiques, ils ne soient pas réticents », a-t-il précisé.
Pour finir, la transition vers l’agroécologie est un enjeu majeur pour l’avenir de l’agriculture. En se formant, en bénéficiant d’un accompagnement adapté et en adoptant des pratiques optimales, les agriculteurs peuvent réussir cette transition tout en garantissant la pérennité de leurs exploitations. Pour Firmain Amadji, « la situation de l’agroécologie demande une certaine indépendance et une certaine autonomie locale nationale. Lorsque nous allons nous porter sur l’étranger pour certains intrants, vous verrez comment ça coûtera Cher. D’ici à quelques années, quelques décennies, nous serons dans des sacs d’engrais qui seront au-delà de 30 000. Quel agriculteur va pouvoir avoir ce pouvoir d’achat et pour quelle agriculture ? » C’est ce qu’il faut donc envisager.
Il est essentiel que chaque acteur et partenaire soutienne le développement durable, en reconnaissant qu’un projet agroécologique doit, au minimum, s’inscrire dans une vision à moyen et long terme.