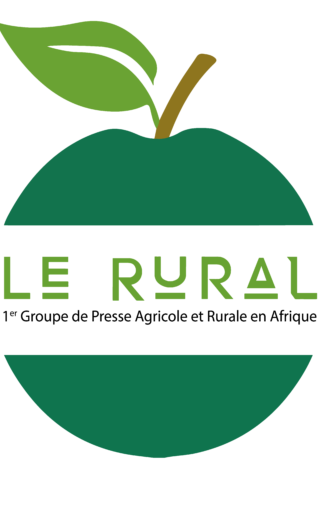Quand l’après-projet devient un défi à double tranchant
L’agriculture est, au Bénin, un secteur vital qui alimente l’économie nationale. Source de revenus, de sécurité alimentaire et de stabilité sociale, elle emploie une large part de la population. Pour booster ce secteur stratégique, l’État béninois a multiplié ces actions. Des milliards ont été injectés dans l’agriculture à chaque campagne agricole pour soutenir les acteurs. À cela s’ajoute l’appui croissant de partenaires techniques et financiers à travers des projets agricoles structurants. Mais une interrogation demeure essentielle. Il s’agit de comment garantir la durabilité des acquis obtenus une fois que les projets prennent fin.

Depuis plusieurs décennies, le Bénin bénéficie de programmes tels que le PADAAM, le PADMAR, le PADIAP, le PDAB, ainsi que de mécanismes comme les subventions du FNDA. Ces initiatives ont permis des avancées notables. Par exemple, dans le nord du pays, la coopérative de vente groupée de chou à Djougou a su rebondir grâce à l’appui d’un nouveau projet, après avoir traversé une période difficile consécutive à la fin d’un précédent programme. Cette expérience montre toutefois que sans dispositifs de pérennisation solides, les efforts peuvent s’effriter rapidement. Plus loin, plusieurs projets et programmes d’aménagements peinent à pérenniser leurs acquis une fois à termes. C’est le cas de plusieurs magasins de stockage construits dans plusieurs localités, mais qui sont à peine utilisés.
Pérenniser les acquis des projets agricoles, un impératif pour un impact durable
Soutenir les producteurs est une étape indispensable dans le développement agricole. Cependant, assurer la continuité des impacts après les projets et cibler les interventions est tout aussi crucial pour éviter que les acquis ne se diluent dans le temps.
Selon Alari-SounonTaïrou, Point Focal du PADMAR à l’ATDA 2, tout commence par l’appropriation communautaire. « Si les producteurs participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des activités, ils se sentent responsables et sont plus enclins à entretenir les acquis », explique-t-il. Cette implication locale est la première condition de durabilité.
Mais pour aller plus loin, Joseph Kiki, Directeur d’Aménagement et Infrastructures à l’ATDA Pôle 4, insiste sur la nécessité de relais communautaires formés. À ses yeux, « il faut aller au-delà des formations ponctuelles » pour garantir une présence continue et un appui technique de proximité, même après la clôture des projets.
Cette approche suppose aussi une organisation concrète de l’entretien des infrastructures. D’après Christian Toudonou, en charge de l’aménagement à l’ATDA, cela passe par des mécanismes locaux comme les cotisations internes ou des accords avec les Atda. Faute de tels dispositifs, trop d’infrastructures sombrent dans l’abandon. Dans cette logique, le rôle du gouvernement devient central. Patrice Dossa, Chef de la Division des Bas-Fonds à la Direction du Génie Rural, propose de confier la gestion des ouvrages au gouvernement à travers les ATDA. Ce transfert de responsabilité permettrait d’assurer un suivi institutionnel continu.
La viabilité économique des acquis des projets agricoles
Par ailleurs, la viabilité économique des projets conditionne leur longévité. Comme le souligne Laurent Avohou, spécialiste en aménagement, « si les producteurs gagnent leur vie grâce aux projets, ils investiront naturellement pour les faire durer ». Marcus Ghislain ZOKPE, Technicien en Production Animale explique ce qui se fait déjà à travers le soutien de ACMA 3.
« Dans la méthodologie du projet, il est prévu, à la fin des essais d’élevage intelligent adapté au climat, de pérenniser les acquis du projet en procédant à une répartition du kit d’élevage. Ce kit sera divisé en deux parts égales (50/50), et la moitié sera remise à un autre éleveur participant activement aux activités du centre de sensibilisation au sein de l’Unité Pédagogique de Démonstration. Ainsi, cet éleveur pourra également valoriser les connaissances et compétences acquises grâce à sa participation à l’UPD bénéficiaire directe du projet », dit-il.
Lire aussi : CAMPAGNE AGRICOLE 2025-2026 : À Lalo, plus de 21 tonnes d’engrais remises aux coopératives de producteurs de maïs
La structuration des bénéficiaires des projets agricoles, un moyen de continuité
Cette pérennisation passe aussi par la structuration des bénéficiaires, dont les coopératives, qui peuvent jouer un rôle clé dans la gestion collective, la mutualisation des ressources et la défense des intérêts des membres. Dans cette dynamique, le suivi post-projet est un levier à ne pas négliger. Joël Daye Loffa, Chef programme cultures maraîchères à l’ATDA Nord, recommande de prévoir dès le départ une phase d’accompagnement d’au moins un an pour renforcer l’ancrage des changements.
Une inclusion active des jeunes et des femmes dans les organes décisionnels des structures agricoles permet non seulement un meilleur ancrage social, mais aussi un renouvellement générationnel vital pour la continuité.
Les projets agricoles démontrent leur efficacité au Bénin. Mais leur impact réel se mesure dans la durée. Pérenniser les acquis, ce n’est pas seulement injecter des fonds, c’est bâtir des systèmes solides, autonomes et adaptés au contexte local. C’est un travail de fond, qui commence dès le lancement du projet, se renforce pendant sa mise en œuvre et se prolonge bien après sa clôture. À ce prix uniquement, les efforts engagés permettront de construire une agriculture béninoise plus résiliente, équitable et durable.
Vignon Justin ADANDE