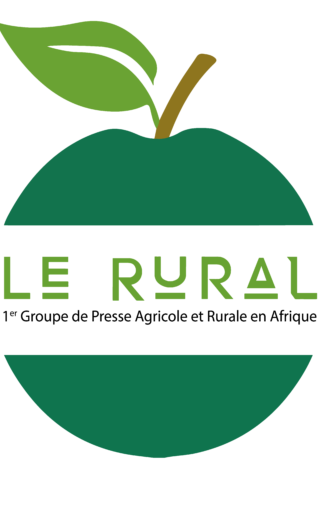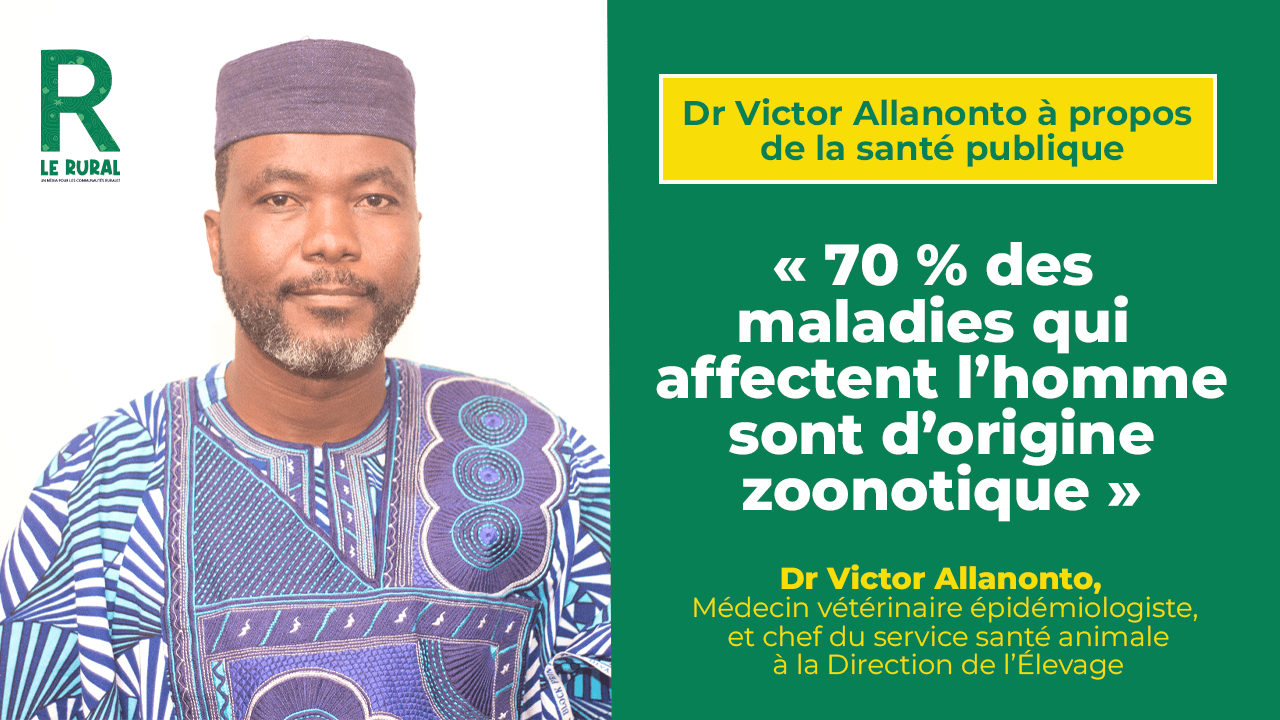« 70 % des maladies qui affectent l’homme sont d’origine zoonotique », Dr Victor Allanonto
Dans de nombreuses fermes rurales, éleveurs et animaux cohabitent souvent sans barrière sanitaire. Une proximité qui expose à des maladies transmissibles dans les deux sens : de l’animal à l’homme, et inversement. Comment s’expliquent-elles ? Et surtout, comment les prévenir ? Dans un entretien accordé à votre journal, Dr Victor Allanonto, Médecin vétérinaire épidémiologiste, et chef du service santé animale à la Direction de l’Élevage parle des maladies zoonotiques et des pratiques d’élevage à risque qui favorisent leur apparition et leur transmission, les facteurs environnementaux et les mesures préventives à adopter.

Qu’est-ce qu’une zoonose et quelles sont les maladies zoonotiques les plus courantes dans les fermes familiales ou exploitations agricoles au Bénin ?
Une zoonose est une maladie ou une infection qui se transmet naturellement des animaux vertébrés à l’homme et vice-versa.
Dans ce contexte, les maladies zoonotiques les plus courantes au Bénin sont essentiellement : la rage, la grippe aviaire, la brucellose, le charbon bactéridien, les fièvres hémorragiques, et la trypanosomose. Mais sachez qu’il existe de nombreuses maladies zoonotiques. On peut en recenser une trentaine, voire une quarantaine, au Bénin. Toutefois, le pays a procédé à une priorisation depuis 2021. Six zoonoses ont été identifiées comme prioritaires, parmi celles que je viens de citer. Ce sont donc ces six maladies qui font l’objet d’une attention particulière.
Quels comportements ou pratiques d’élevage exposent le plus les éleveurs à ces maladies ?
Grâce ou plutôt à cause des changements climatiques, de nombreux microbes pathogènes qui se transmettent des animaux à l’homme ont quitté leur biotope naturel, généralement les grandes forêts. Aujourd’hui, avec la déforestation, l’homme est de plus en plus en contact avec les porteurs de ces microbes, qui sont les animaux. C’est l’un des facteurs de l’émergence des zoonoses.
À cela s’ajoute le commerce international. Les échanges entre pays favorisent la circulation rapide des agents pathogènes. Une zoonose qui éclate dans un pays éloigné, comme la Chine, peut arriver rapidement au Bénin par le biais des échanges, des transports ou des voyageurs.
Par ailleurs, ces microbes eux-mêmes cherchent à survivre et s’adaptent. Ils mutent, changent de forme, ce qui leur permet de passer d’une espèce à une autre. Un virus habituellement hébergé par les animaux peut muter et s’adapter à l’homme.
L’Organisation mondiale de la Santé estime qu’au moins 70 % des maladies qui affectent l’homme sont d’origine zoonotique. Cela nous amène à parler des pratiques d’élevage à risque.
Dans les élevages, qu’ils soient familiaux, modernes ou industriels, l’hygiène et la biosécurité sont des éléments fondamentaux. Un manque d’hygiène, se laver les mains, porter des gants, des équipements de protection, disposer d’un dispositif de lavage approprié peut favoriser la transmission de maladies.
La biosécurité concerne aussi des dispositifs visant à empêcher l’introduction d’un microbe dans une ferme ou sa propagation vers l’extérieur. Le vétérinaire conseille généralement sur ces mesures.
Il faut aussi parler de la gestion des cadavres d’animaux. Leur manipulation doit se faire avec précaution et dans le respect de normes environnementales.
Autre facteur important, c’est le niveau de formation des éleveurs. Un éleveur mal informé ne perçoit pas les risques de transmission. En résumé, ce sont l’hygiène, la biosécurité, la gestion des animaux morts et la formation qui déterminent le niveau d’exposition des éleveurs aux zoonoses.
Vous avez parlé des échanges entre pays. Est-ce que les zoonoses varient selon les pays ?
Il existe une liste internationale de maladies zoonotiques reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé. Cependant, certains pays sont indemnes de certaines zoonoses, alors que d’autres en sont fortement affectés. La répartition des microbes n’est pas uniforme. Ainsi, un voyageur en provenance d’un pays touché peut, s’il n’est pas bien contrôlé, introduire la maladie dans un pays indemne.
Existe-t-il des zoonoses qui passent inaperçues chez l’animal, mais qui peuvent être transmises à l’homme ?
Oui, c’est même l’un des défis majeurs de la lutte contre les zoonoses. De nombreuses maladies se manifestent de manière asymptomatique chez l’animal, sans signes cliniques visibles. C’est pour cela qu’on insiste autant sur les bonnes pratiques d’hygiène et de biosécurité.
Prenons l’exemple de la brucellose. C’est une maladie qui peut être transmise par le lait des bovins, même si ceux-ci ne présentent aucun symptôme. Si ce lait n’est pas bien pasteurisé, l’homme peut être infecté.
Autre exemple : la rage. Un chien peut héberger le virus de la rage pendant plus de deux mois sans montrer de signes. S’il mord quelqu’un pendant cette période, cela peut entraîner de graves conséquences.
La toxoplasmose est aussi une zoonose asymptomatique chez l’animal, mais transmissible à l’homme. Il existe ainsi plusieurs maladies invisibles chez l’animal qui représentent un danger pour l’homme. D’où l’importance des mesures de prévention.
Vous avez dit que la transmission est possible dans les deux sens : l’homme peut aussi contaminer l’animal ?
Lorsqu’un homme est atteint de la tuberculose et qu’il vit avec un chat ou un chien, il peut transmettre la maladie à l’animal. On a également observé cela avec la COVID-19. Des animaux de compagnie vivant avec des personnes infectées ont été testés positifs au virus. C’est pour cela qu’on parle de transmission « vice-versa ».
Quelles mesures concrètes recommandez-vous aux éleveurs pour limiter les risques de transmission dans les exploitations familiales ?
D’abord, les mesures d’hygiène de base : se laver les mains, porter des gants et des blouses, avoir des chaussures dédiées à la ferme. Après avoir manipulé un animal mort, il faut bien se laver les mains ou désinfecter. Il faut également éviter de consommer la viande d’un animal mort naturellement. C’est une pratique à haut risque. Il est aussi important d’avoir un dispositif pour les visiteurs : un point de lavage des mains, un bac de désinfection pour les pieds, etc.
Les cadavres d’animaux doivent être bien gérés : enterrés dans une fosse adaptée et à distance des habitations. Cela participe à la protection de l’environnement. Ces mesures doivent être accompagnées par les conseils des vétérinaires. Ce sont eux qui, au quotidien, sensibilisent les éleveurs à la biosécurité.
Parfois, dans les villages, il n’y a pas de séparation entre les animaux et les humains dans les habitations. Que recommandez-vous dans ce cas ?
C’est l’élevage traditionnel. Même dans ce cadre, on peut appliquer une biosécurité dite « traditionnelle ». Cela commence par la séparation des espèces : moutons, porcs, volailles… Chaque espèce doit avoir un espace dédié pour manger.
Il faut aussi maintenir la propreté des lieux. Balayer les enclos, désinfecter les surfaces. Aujourd’hui, il existe des désinfectants peu coûteux, accessibles même en milieu rural, à utiliser chaque semaine ou tous les quinze jours, pour réduire la charge microbienne.
La biosécurité, c’est un concept de propreté. Même une maison en terre battue peut être propre si on respecte certaines règles. Ce n’est donc pas une question de modernité, mais d’organisation et de rigueur.
Votre mot de fin ?
Je dirais que la lutte contre les zoonoses est un enjeu majeur de santé publique mondiale. Elle doit se mener selon l’approche « Une seule santé » (One Health), c’est-à-dire une collaboration entre médecins, vétérinaires, agronomes et spécialistes de l’environnement.
Un virus qui émerge chez l’animal peut, en franchissant la barrière des espèces, contaminer l’homme et d’autres animaux. Il est donc essentiel de travailler ensemble, en synergie, pour mieux prévenir et contenir ces maladies.
Réalisé par Vignon Justin ADANDE