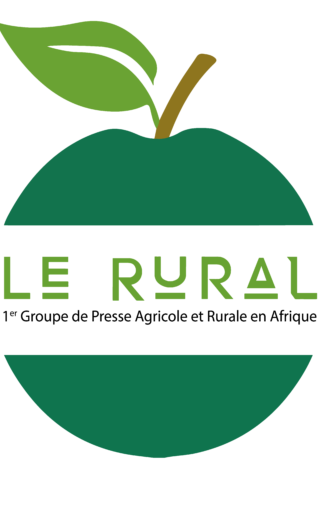Baobab africain, anacardier et karité, etc.
Au Bénin, plusieurs espèces d’arbres sont menacées de disparition. Et ce, à cause des effets néfastes du changement climatique, selon une récente étude publiée dans la revue Elsevier.
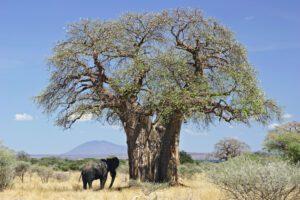
Des espèces utiles en voie de disparition et d’autres qui résistent
Le baobab africain, l’anacardier et le karité sont les espèces susceptibles de disparaitre, surtout dans les zones protégées. En revanche, d’autres espèces comme le palmier à huile (Elaeis guineensis) et le rônier (Borassus aethiopum) font preuve de résilience, avec des expansions potentielles dans des habitats appropriés, leur permettant de s’adapter aux conditions climatiques futures.
Étendue de l’étude : du littoral aux zones protégées
De manière concrète, l’étude a pris en compte les zones périurbaines des villes de Cotonou, Abomey, Savalou, Parakou, Natitingou, Kandi et le réseau d’aires protégées au Bénin, notamment le Parc national de la Pendjari, le Parc national du W, la Réserve forestière de la Lama, la Vallée de l’Ouémè et les zones humides de la Bouche du Roi. Grâce à cette approche, elle a permis aux auteurs d’évaluer les variables environnementales influençant leur distribution, de projeter les changements d’habitat, d’identifier les points chauds et de comparer les impacts sur les espèces indigènes et non indigènes.
Des habitats appropriés en mutation
Par ailleurs, les chercheurs ont modélisé les futurs habitats propices aux douze espèces d’arbres étudiés, selon deux scénarios climatiques. « Les projections ont indiqué un déclin des habitats appropriés pour 67 % des espèces, des changements mineurs pour 8 % et des augmentations pour 25 % », peut-on lire. Toutefois, l’efficacité des aires protégées était mitigée, les espèces montrant des réponses variées.
Zones périurbaines : de nouveaux foyers de conservation
En conséquence, les zones périurbaines de Savalou et d’Abomey sont apparues comme des points chauds de conservation clés, soulignant la nécessité de déplacer l’accent de la conservation vers ces zones. Par ailleurs, les espèces indigènes ont montré une plus grande résilience aux conditions climatiques futures, soulignant l’importance des espèces indigènes et des stratégies de conservation spécifiques aux espèces dans un contexte de changement climatique.
Des limites dans le système actuel de conservation
En outre, l’étude souligne également l’insuffisance potentielle des aires protégées actuelles pour la sauvegarde des espèces d’arbres polyvalents, car de nombreux points chauds d’habitats appropriés sont situés en dehors de ces zones, en particulier dans les zones soudano-guinéennes inférieures et guinéennes supérieures.
Pour finir, il est nécessaire de développer des stratégies de gestion pouvant améliorer la conservation des 12 espèces d’arbres à usages multiples étudiées. En effet, les auteurs indiquent que leur intégration dans les pratiques de verdissement urbain et d’agroforesterie dans les zones périurbaines, soutenue par des cadres politiques stratégiques, peut améliorer la connectivité des habitats, promouvoir la résilience des écosystèmes et contribuer au développement urbain durable.
Eu égard à la résilience des espèces indigènes par rapport aux espèces non-indigènes, ils suggèrent que les efforts de conservation donnent la priorité aux espèces indigènes tout en gérant soigneusement les espèces non-indigènes, pour soutenir la biodiversité sans perturber les écosystèmes locaux.
Lire aussi : FILIÈRE MANGUE AU BÉNIN : 4587 plants de variétés Amélie et Kent certifiés à Natitingou
Jean-Baptiste HONTONNOU