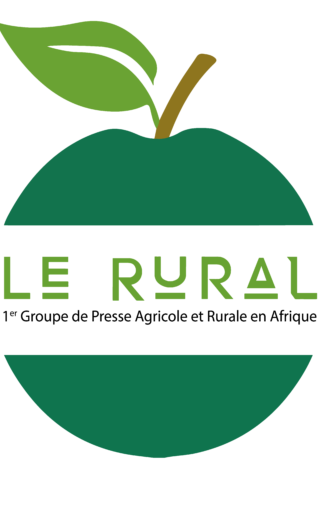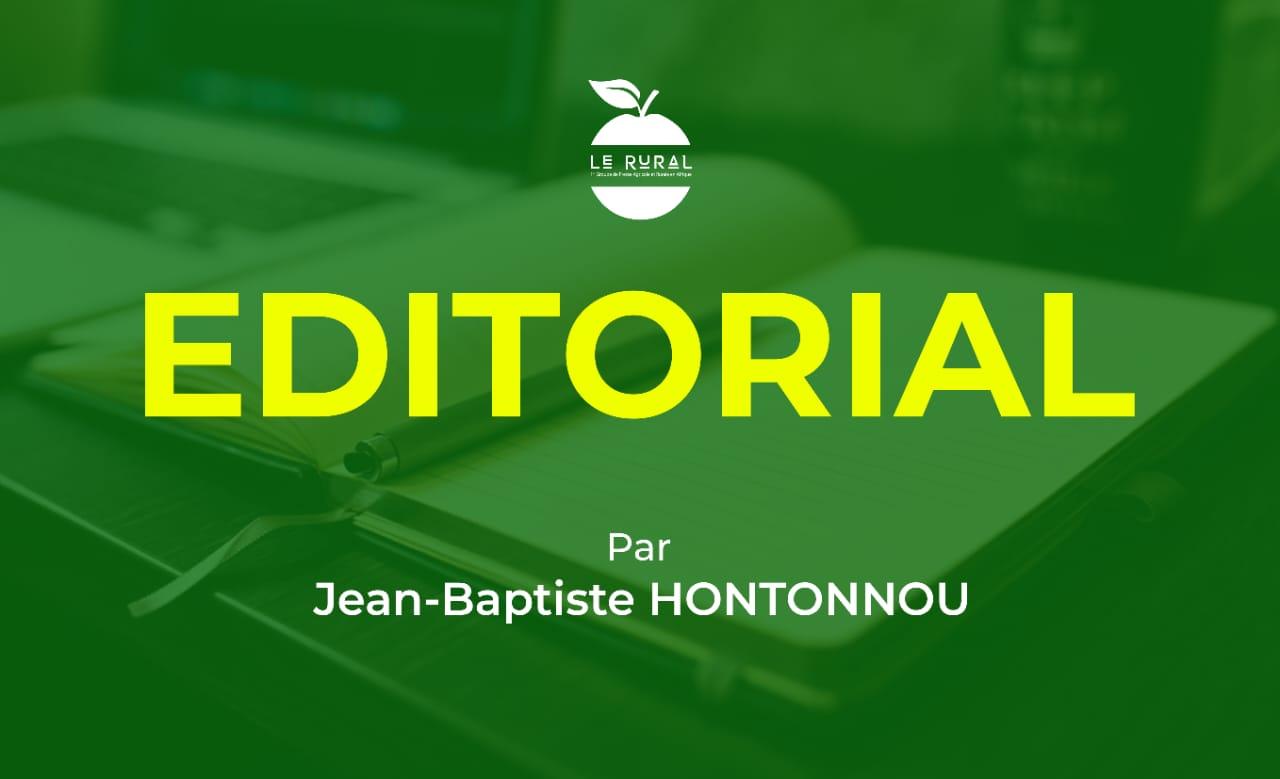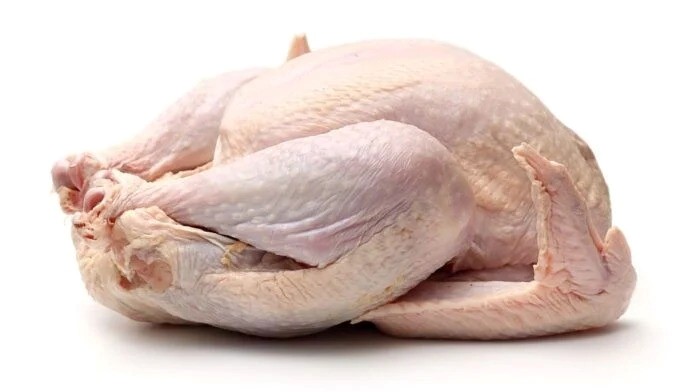Au Bénin, un sujet semble faire l’unanimité, même de manière discrète : la souveraineté semencière. Projets, initiatives, structures… tout semble avoir été tenté. Pourtant, rien ne prend vraiment. Et les défenseurs des semences locales ne cessent de tirer la sonnette d’alarme. Leur inquiétude est d’autant plus grande face à l’insistance de certains à vouloir faire adhérer le pays à l’UPOV, cette organisation intergouvernementale qui promeut les droits des obtenteurs, au détriment des droits des paysans.

Aujourd’hui, les semences dites « améliorées » ; souvent importées, hybrides, voire génétiquement modifiées ; envahissent les marchés. Protégées par des brevets et des droits de propriété intellectuelle, elles restreignent fortement les marges de manœuvre des producteurs. Ces derniers ne peuvent ni reproduire, ni échanger librement les semences. Chaque saison agricole devient alors un nouveau cycle de dépendance.
Et pourtant, cette situation n’a rien d’inéluctable. Le Bénin regorge de variétés locales, adaptées à nos sols, à nos climats et à nos savoir-faire. Conservées par les communautés rurales, ces semences paysannes sont souvent plus résilientes face aux aléas climatiques. Mais elles sont marginalisées, parfois interdites et menacées d’extinction faute de cadre juridique clair. Pendant ce temps, le modèle certifié gagne du terrain, imposant une vision uniforme de l’agriculture.
Lire aussi : ÉDITORIAL : L’Entrepreneuriat des Jeunes en Afrique
Face à cette réalité, il ne s’agit plus simplement de réfléchir : il y a urgence. Urgence de repenser notre système semencier. Urgence de le refonder sur nos priorités fondamentales : la sécurité alimentaire, la biodiversité, la résilience paysanne.
Car toute souveraineté alimentaire commence par la graine. Par la semence. Il ne s’agit pas de rejeter l’innovation, mais de garantir que les producteurs soient pleinement acteurs et décideurs de ce qu’ils sèment.
Par Jean-Baptiste HONTONNOU