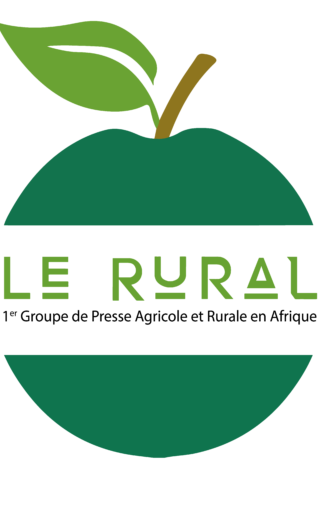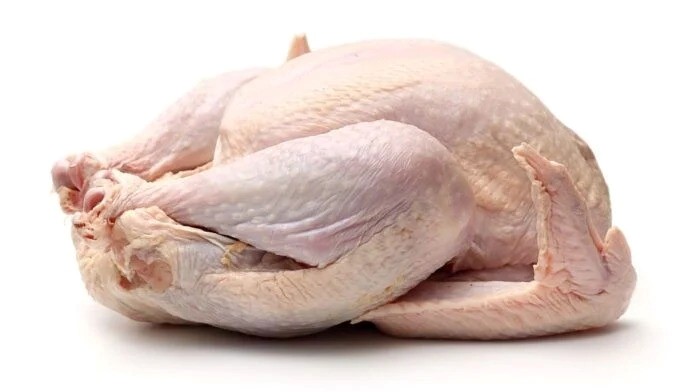Au Bénin, les légumes sont omniprésents sur les étals des marchés, mais restent encore trop peu présents dans les assiettes. En moyenne, un Béninois ne consomme que 105 grammes de fruits et légumes par jour, soit environ 40 kilos par an, un chiffre bien loin des 400 grammes quotidiens recommandés par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Pourtant, ces aliments jouent un rôle central dans la prévention des maladies, la vitalité et le bien-être des populations. Entre pratiques agricoles parfois risquées, méthodes de préparation qui réduisent la valeur nutritive des légumes et habitudes alimentaires déséquilibrées, les légumes occupent une place fragile dans le quotidien des Béninois. Comprendre leur consommation et identifier les leviers pour mieux s’alimenter devient essentiel pour préserver la santé et le bien-être.

Les légumes jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la malnutrition et les maladies non transmissibles. Selon les experts, un légume est « toute partie comestible d’une plante consommée crue ou faiblement transformée ». On distingue plusieurs catégories : les légumes feuilles (jardin man, gboman, tchiayo, salades), les légumes fruits (gombo, tomate, piment), les légumes racines (carotte, pomme de terre) et les légumes fleurs (bissap, chou-fleur). Cette diversité permet de couvrir un large spectre de vitamines et de minéraux indispensables à la santé.
Selon la nutritionniste Fifamè Loristia Kpadonou, les légumes sont composés d’eau, de fibres alimentaires, de vitamines (C, B, A, K), de minéraux (potassium, fer, magnésium), de glucides et de composés antioxydants (caroténoïdes, anthocyanines).
Grâce à ces bienfaits ou sur recommandations médicales, certains foyers béninois reconnaissent l’importance de consommer des légumes. Dans ces maisons, ils se retrouvent dans presque tous les plats : sauces, accompagnements, salades.
Selon le ministre de l’Agriculture, Gaston Cossi Dossohou l’analyse de la situation alimentaire au Bénin révèle un déficit important en fruits et légumes. « La consommation de fruits et légumes par habitant, par jour, est d’environ 107 g, soit à peine 40 kg par habitant et par an. Vous conviendrez que les normes de la FAO tournent autour de 80 à 100 kg/personne/an », avait affirmé le ministre Gaston Cossi Dossohoui lors du lancement du projet SAFEVEG West Africa, officiellement lancé le vendredi 5 février 2021 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou.
Les consommateurs rencontrés sur les marchés d’Akassato et de Kpota confirment cette faible consommation. « Les fruits et légumes, oui, on en consomme assez souvent. Déjà parce que c’est un plaisir, mais aussi parce que c’est bon pour la santé », témoigne Mireille Allobatin, commerçante à Kpota. « Chez nous, on mange des légumes, mais pas tous les jours. Les enfants préfèrent la pâte et le riz », confie Prudence, mère de famille à Abomey-Calavi.
Pour beaucoup, les légumes restent secondaires par rapport aux féculents (igname, riz, gari). Le prix, la perception de satiété et parfois la méconnaissance de leurs bienfaits expliquent ce déséquilibre alimentaire.

Bien produire, bien préparer, bien consommer : la clé pour tirer profit des légumes
Pour ceux qui en consomment, certains légumes sont consommés crus, comme la laitue, souvent lavée et parfois trempée dans une solution vinaigrée ou légèrement salée avant d’être servie en salade. D’autres légumes feuilles sont cuits à l’eau, parfois additionnée de bicarbonate ou de potasse, et certaines variétés amères, comme l’amanvivè, sont triturées pour atténuer leur goût avant d’être intégrées aux sauces. La friture et la cuisson à la vapeur sont également pratiquées, cette dernière étant privilégiée pour préserver les nutriments et le goût.
Cependant, une chose est de consommer des légumes, l’autre est de savoir les préparer correctement. La manière de les préparer influence fortement leurs bienfaits. Dans les foyers, les habitudes traditionnelles de préparation varient, mais de nombreuses mauvaises pratiques compromettent la qualité nutritionnelle et sanitaire des légumes. La découpe excessive, le trempage prolongé et le pressage entraînent la perte de vitamines hydrosolubles telles que les vitamines B et C, ainsi que de minéraux essentiels. Les cuissons prolongées à l’eau ou à haute température détruisent une partie des nutriments, tandis qu’un lavage insuffisant laisse des résidus de pesticides et des microbes susceptibles de provoquer des troubles digestifs. « Les légumes mal lavés ou mal cuits peuvent devenir un vecteur silencieux de maladies », avertit Yann Eméric Madode, enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences Agronomiques (UAC).
Pascaline Hounsou, vendeuse au marché d’Akassato, confie : « À la maison, on met beaucoup de tomates dans la sauce, mais les enfants n’aiment pas les légumes verts. Et les rares que nous préparons, je fais de la sauce d’épinards ou de gboman, mais souvent, je laisse mijoter trop longtemps. »
Roland Gamon, chef cuisinier formateur et consultant en hôtellerie-restauration, insiste sur l’importance du savoir-faire culinaire. « Mieux transformer les légumes, c’est mieux s’alimenter. Une cuisson trop longue détruit vitamines et minéraux. La vapeur, les sautés rapides ou même les légumes crus sont les meilleures options pour préserver leur valeur nutritive tout en sublimant leurs saveurs. »
La nutritionniste Fifamè Loristia Kpadonou ajoute : « Il faut diversifier les légumes consommés : feuilles vertes, racines, légumineuses… L’oignon et la tomate ne suffisent pas à couvrir les besoins nutritionnels. La variété est la clé d’une alimentation équilibrée. »
La transformation des légumes va au-delà de la cuisine domestique. Le séchage, la mise en conserve et la surgélation représentent des alternatives pour réduire les pertes post-récolte et garantir une disponibilité toute l’année, même en période de soudure.
Dr Gracias Koukoubou, médecin généraliste, souligne : « Une alimentation pauvre en légumes accroît les risques d’hypertension, de diabète ou d’obésité. Les légumes sont des protecteurs naturels de l’organisme. »
Produire sain et consommer mieux : un enjeu collectif
Une chose est de consommer et de savoir les modes de cuisson, une autre est de bien les produire. Sur plusieurs sites maraîchers comme Sèmè-Kpodji et Abomey-Calavi, les producteurs travaillent dans des conditions difficiles, entre manque d’eau, accès limité aux intrants de qualité et forte pression foncière. « Ici, pour que les légumes poussent vite et résistent aux insectes, beaucoup de cultivateurs utilisent des produits chimiques », avoue Jacques, jeune maraîcher à Sèmè-Kpodji. « Mais parfois, si la demande est forte, on ne respecte pas les délais avant de vendre, et les résidus restent sur les légumes », a-t-il ajouté.
Face à ces contraintes, certains recourent à des pesticides mal dosés, mettant en péril la sécurité alimentaire. Pour Yann Eméric Madode, « Il ne suffit pas de produire beaucoup, il faut produire sain. L’usage abusif de produits chimiques expose les consommateurs à des risques sanitaires graves. La promotion de pratiques agroécologiques, comme le compost ou la rotation des cultures, est une solution durable. »
Les légumes ne sont pas de simples accompagnements. Ils sont au cœur de la santé publique et de la lutte contre les maladies chroniques. Mieux les produire, mieux les préparer et mieux les consommer n’est pas seulement une question individuelle, mais un enjeu collectif. Selon Yann Eméric Madode, les autorités doivent accompagner les producteurs par des subventions, des formations et la mise à disposition de semences améliorées. Les consommateurs, eux, doivent être sensibilisés dès le jeune âge. Il recommande de privilégier les fruits et légumes de saison et de diversifier leur consommation pour en tirer pleinement profit.
Comme le résume Fifamè Loristia Kpadonou : « La santé commence dans l’assiette. Les légumes sont des alliés incontournables pour bâtir une société en meilleure santé. »
Vignon Justin ADANDE