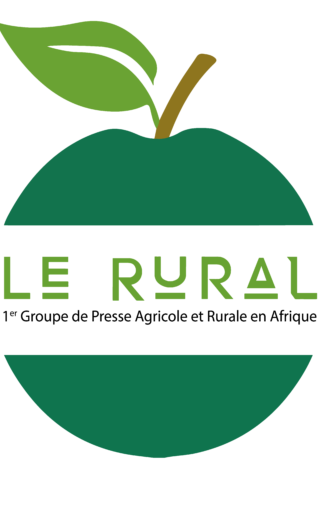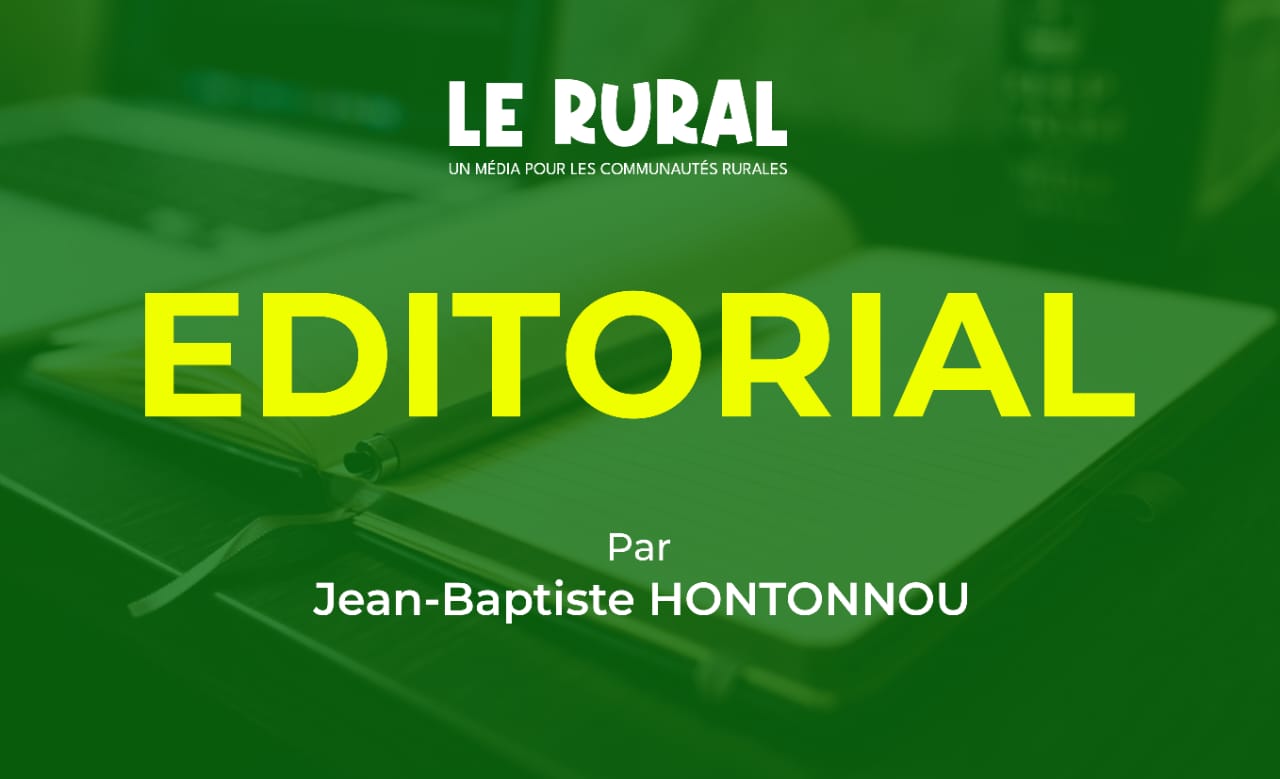Les indicateurs de pauvreté et d’équité évoluent lentement au Bénin, malgré une croissance économique continue ces dernières années. Comment expliquer que la prospérité reste si peu inclusive ?

Dans son rapport sur les perspectives économiques du Bénin publié en juin 2025, la Banque mondiale a relevé cinq facteurs majeurs expliquant ce contraste de plus en plus incompris.
En premier lieu, il faut noter la faible productivité pour créer des emplois de qualité. En effet, la croissance économique du Bénin repose sur des secteurs à faible productivité. La productivité globale des facteurs (PTF) a reculé en moyenne de -0,8 point entre 2011 et 2019, puis de -1,5 point entre 2020 et 2023.
Au niveau des entreprises, la productivité du travail a chuté de 9,2 % en 2016. Les grandes entreprises demeurent pourtant 4,5 fois plus productives que les petites et 3 fois plus que les moyennes. Mais, la prédominance de l’informel où les travailleurs sont 20 à 40 % moins productifs que dans le formel, freine l’économie.
En conséquence, près de 77,6 % des emplois étaient encore vulnérables en 2022, contre seulement 65,7 % dans les pays comparables.
Les secteurs qui emploient le plus créent peu de richesse
Les principaux pourvoyeurs d’emplois non agricoles entre 2010 et 2022 tels que : le commerce de gros et de détail (0,65 point), la fabrication (0,43), autres services (0,48) et la restauration/hébergement (0,23) contribuent plus à l’emploi qu’à la croissance. À titre d’exemple, le commerce a généré 0,65 point dans l’emploi, mais seulement 0,5 point dans la croissance. En revanche, les secteurs à forte valeur ajoutée par travailleur, comme la finance, les transports ou les télécoms, ont vu leur contribution à la croissance être 3 à 4 fois plus élevée que leur création d’emplois. Cela accentue le décalage entre développement économique et création d’emplois de qualité.
Les inégalités d’accès freinent le capital humain
Au Bénin, l’avenir d’un enfant dépend largement de son lieu et de ses conditions de naissance. Malgré les nombreux efforts consentis, l’accès inégal à l’éducation, à la santé et aux infrastructures de base limite encore le capital humain et compromet la mobilité sociale. Ces inégalités renforcent la pauvreté intergénérationnelle. De nombreux enfants, en particulier les filles, voient leurs perspectives de revenus durablement réduites.
Les disparités persistantes entre hommes et femmes
La Banque mondiale révèle que le taux d’activité des femmes est de 54 %, soit 14 points de moins que celui des hommes. Près de 67 % des femmes travaillent dans l’agriculture familiale, contre 22 % des hommes. L’accès limité aux postes de décision, la dépendance économique vis-à-vis des hommes, la faible représentation politique font partie des normes sociales et culturelles qui renforcent ces inégalités et freinent la croissance inclusive et l’émergence d’une économie équitable.
Des distorsions du marché et des institutions limitent l’accès à des opportunités plus productives et génératrices de revenus.
Les contraintes structurelles telles que l’accès au financement, la faiblesse des technologies disponibles, l’inefficacité institutionnelle limitent la productivité des entreprises et des exploitations agricoles. Elles freinent également la création d’emplois salariés de qualité et réduisent les opportunités de revenus. Ainsi, elles maintiennent une grande partie de la population dans la pauvreté.
Maëlle ANATO