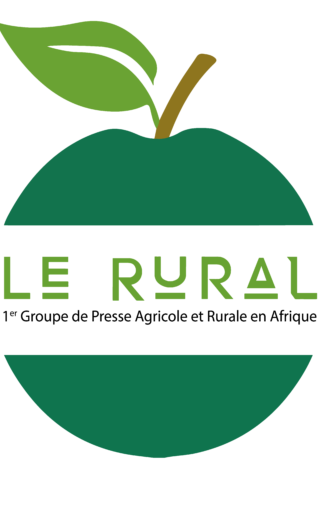Une étude révèle des taux de pertes relativement bas
Dans plusieurs pays africains, la conservation de plusieurs produits agricoles, surtout ceux maraîchers rencontre toujours plusieurs. Face donc au problème d’énormes pertes observées après chaque récolte, un travail de recherche est parvenu à tirer des enseignements en Côte d’Ivoire et Sénégal.

Plus de peur que de mal. Cette étude réalisée dans le cadre du projet SAFOODS a déjoué tous les pronostics. Contrairement aux estimations habituelles qui valent les pertes post-récolte des producteurs entre 10% et 25% de la récolte, l’étude a révélé des taux de pertes relativement bas dans les deux pays.
En effet, pendant cette recherche, Roosvelt Love Azefack a utilisé les données d’enquête recueillies auprès de 304 producteurs de tomates dans 5 régions des deux pays, et a défini les pertes comme le taux individuel de produits jetés (pertes quantitatives) et invendus/bradés en raison de la qualité (pertes qualitatives). « Nous trouvons que les pertes sont en moyenne respectivement de 3,2 % pour les pertes quantitatives et de 5,4 % pour les pertes qualitatives », va affirmer l’auteur à l’issue de son étude. Il faut souligner que des disparités importantes sont observées entre les régions et les producteurs.
Aussi, une analyse en correspondance a été réalisée. Ce qui a permis de mettre en évidence « une typologie des producteurs en fonction de leurs pratiques. Cette typologie révèle que les pratiques agricoles sont spécifiques à chaque région et les pertes sont plus élevées au Sénégal qu’en Côte d’Ivoire ». Plus loin, les stratégies de production et de commercialisation des producteurs influencent les pertes post-récolte pour ce maillon de la chaîne de valeur, mais probablement aussi pour ceux en aval.
Pour finir, l’un des plus grands enseignements retenus dans le cadre de cette étude est que ces résultats préliminaires obtenus montrent la diversité de modèles pour une même spéculation à l’échelle sous-régionale et la nécessité de concevoir des solutions tenant comte de ces spécificités pour réduire les pertes et améliorer la sécurité alimentaire.
Lire aussi : Filière palmier à huile au Bénin : Une production record de plus de 900 000 tonnes par an
Jean-Baptiste HONTONNOU