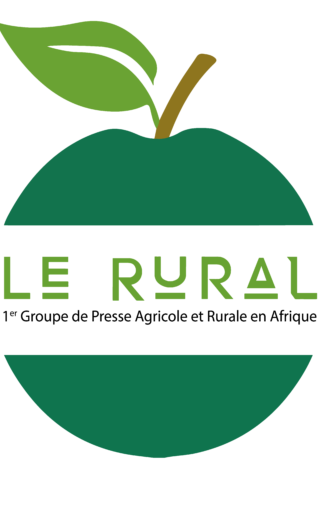La production maraîchère assure l’approvisionnement des marchés béninois en légumes frais et constitue également une source de revenus pour de nombreux producteurs béninois. En période de contre-saison, les agriculteurs s’approprient certaines techniques culturales pour réduire le coût des denrées alimentaires et faciliter un tant soit peu l’accès des consommateurs à des produits qualitatifs.

Les tomates, les carottes, les oignons ou encore les piments sont autant de légumes pour lesquels la disponibilité constante est assurée par le maraîchage de contre-saison. Au Bénin, cette période s’étend généralement d’octobre à janvier dans le septentrion et de novembre à février dans le Sud. C’est une période sèche qui se caractérise au fil des ans par des conditions climatiques défavorables, des températures élevées et un déficit pluviométrique. Les vagues de chaleur accentuent l’évaporation et réduisent la productivité des cultures.
À ces défis climatiques s’ajoutent la persistance du manque d’eau pour l’arrosage des plantes. En conséquence, les denrées, comme le piment, la tomate ou la laitue, connaissent souvent une flambée de prix en contre-saison. Des publications hebdomadaires de l’InSTAD en ce début de janvier 2025, il ressort que les prix de la tomate fraîche et du piment frais sont en augmentation dans les marchés de toutes les villes échantillonnées. Selon les commerçants des marchés de Cotonou, Abomey-Calavi et Ouidah, un panier de tomates peut doubler de prix entre décembre et mars, passant de 10 000 à 20 000 FCFA en raison de la raréfaction.
Lire aussi : CULTURE DU MAÏS EN CONTRE-SAISON AU BÉNIN : Une alternative compensatrice de la période de soudure
Face à ces difficultés, les maraîchers s’en remettent à des solutions dans le but de satisfaire la demande du marché même en contre saison. Dans le Nord par exemple, les eaux de surface et souterraines sont les principales sources utilisées pour subvenir au besoin en eau des cultures maraîchères. Bien qu’alimentées par les précipitations en saison pluvieuse, ces points d’eau restent à sec de décembre à mai. Pendant cette période, l’irrigation goutte à goutte assure l’arrosage efficient dans les champs de culture.
Elle utilise moins d’eau tout en assurant un apport constant. Dans certains cas, elle est associée au paillage ou à l’utilisation des tapis de paillage (en plastique ou en fibres naturelles) qui maintiennent l’humidité du sol. Dans le souci de réduire les coûts de production, des maraîchers effectuent le paillage en recouvrant le sol de feuilles, d’herbes et d’autres débris végétaux.
En outre, les pratiques maraîchères reposent sur des choix stratégiques en fonction de la durée des cycles, des besoins en eau, en intrants (engrais, pesticides), et de l’espace disponible. En période de contre saison, les cultures à cycle court (1,5 à 2 mois) comme la laitue et le chou sont largement privilégiées, car elles permettent une récolte rapide, nécessitent peu de main-d’œuvre, et s’adaptent mieux aux insuffisances de pluie. À l’inverse, les cultures de 3 à 4 mois comme le piment et le gombo demandent une certaine quantité d’eau et d’entretien. Ce qui impacte davantage leur disponibilité et la tendance des prix sur le marché.
Sur des exploitations, il n’est pas rare de constater que l’association de culture d’espèces à cycles différents (chou-laitue ou tomate-gombo) permet d’optimiser l’espace. Chez d’autres maraîchers, la rotation des cultures est également un moyen d’assurer une production continue et d’éviter l’épuisement des sols. À titre d’exemple, le chou ou l’amarante servent de tête de culture et sont suivis d’espèces comme la laitue, la tomate ou la carotte.
Maëlle ANATO