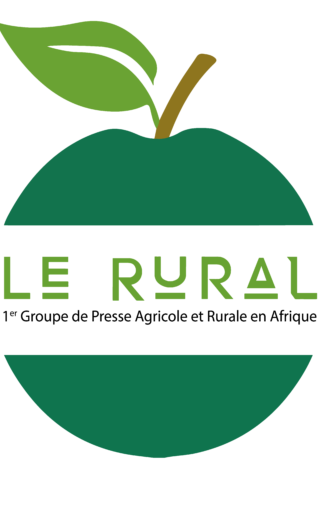Plus qu’un tubercule, une identité à la fois traditionnelle et économique
Au Bénin, parler de l’igname, c’est parler de culture, de tradition et même d’économie, mais d’abord l’agriculture. Ce tubercule n’est pas qu’un aliment : il rythme les saisons agricoles, marque une fête populaire et renforce les liens sociaux. Dans les campagnes comme dans les villes, il incarne une identité partagée, célébrée et fièrement transmise.

La fête de l’igname à Savalou
En effet, chaque 15 août, Savalou devient le cœur battant du pays. La fête de l’igname attire des foules venues de toutes les régions et même de la diaspora. Dès la veille, la ville change de visage : prêtres, dignitaires, roi et habitants se rassemblent pour les prières, les offrandes et les sacrifices destinés aux ancêtres. C’est un moment de recueillement, mais aussi de préparation à une célébration qui s’annonce grandiose.
Le jour J, les premières ignames de la saison sont présentées au roi GBAGUIDI TOSSO de savalou. Ce geste solennel marque l’autorisation officielle de consommer le tubercule. Ensuite, tout s’accélère : les rues se remplissent de danses, de chants, de spectacles, de jeux traditionnels et de grandes tablées. L’igname, sous toutes ses formes, devient la star des assiettes.
Un poids économique considérable
Les chiffres confirment cette importance. En 2022, la production nationale a atteint environ 3,2 millions de tonnes, un résultat solide par rapport à l’année précédente. Le record le plus proche remonte à 2019 avec plus de 3,36 millions de tonnes, selon les données de la FAO. Ces volumes impressionnants placent le Bénin au quatrième rang mondial, derrière le Nigeria, le Ghana et la Côte d’Ivoire.
L’importance du « laboco »
Mais l’igname, c’est aussi une histoire de variétés. Lors de la fête, la plus attendue reste la laboco : un tubercule conique, considéré comme la première récolte de la saison. Sa particularité ? Elle reste neuf mois sous terre, comme une gestation humaine, ce qui nourrit une symbolique forte. Dans les villages de la commune de Savalou, considérée dans ce contexte comme un royaume, on dit que sa sortie de terre est une véritable « naissance », fêtée avec enthousiasme comme événement familial.
Les rituels qui entourent la fête sont empreints de spiritualité. Après les sacrifices, le Fâ est consulté. Il détermine si la nouvelle igname peut être consommée. Une fois l’accord obtenu, les réjouissances prennent une autre dimension : tam-tams, chants, danses et, bien sûr, dégustations d’igname pilée accompagnée de sauces locales, souvent celle d’arachide.
À Cotonou, l’igname ne se vit pas seulement dans les cérémonies. Les marchés, comme celui de Dantokpa, connaissent un pic d’activité dès la saison de sortie. Le prix du laboco varie entre 2 500 et 5 000 francs CFA le tas de trois, avec une hausse notable avant la fête. Les revendeuses, souvent des experts de la négociation, savent que la demande est au plus haut.
L’igname est aussi un puissant vecteur de cohésion sociale. Pendant la fête, chrétiens, musulmans et adeptes des religions traditionnelles partagent le même espace, les mêmes repas et la même joie. Les thèmes annuels de la célébration, choisis par la communauté, permettent également de discuter des enjeux locaux : développement, solidarité, protection de l’environnement.
Au-delà de l’instant festif, la fête joue un rôle dans la transmission culturelle. Les anciens y enseignent aux jeunes les gestes de la culture de l’igname, les chants rituels et les récits historiques. Ainsi, ce tubercule devient un lien intergénérationnel, ancré dans la mémoire collective, surtout à Savalou.
Défis et perspectives pour la filière igname
Pourtant, l’igname béninoise n’échappe pas aux menaces. Les variations climatiques, en particulier les pluies irrégulières, inquiètent les producteurs. Certaines années, les récoltes sont moins abondantes et les tubercules moins savoureux, ce qui affecte directement la qualité des plats traditionnels comme l’agou (igname pilée).
Face à ces défis, l’État et ses partenaires misent sur la modernisation de la filière. Des programmes soutenus par la FAO et d’autres organisations visent à améliorer l’accès aux semences, aux intrants, aux techniques de conservation et aux débouchés commerciaux. L’idée est de sécuriser les revenus des producteurs tout en garantissant une disponibilité constante du produit sur les marchés.
Dans l’économie nationale, l’agriculture occupe une place stratégique : près de 32,7 % du PIB, environ 70 % des emplois et 75 % des exportations. L’igname, au même titre que le maïs ou le manioc, joue un rôle central dans cette dynamique. Elle est à la fois une denrée de consommation courante et un produit à potentiel commercial élevé.
L’igname au Bénin, c’est bien plus qu’une racine enfouie dans la terre. C’est un symbole d’identité, un pilier de l’économie, un patrimoine culturel et un moment de communion nationale. Elle relie les champs aux palais, les marchés aux foyers, les anciens aux jeunes. Et chaque bouchée d’igname pilée raconte un peu de cette histoire.
Innocent AGBOESSI