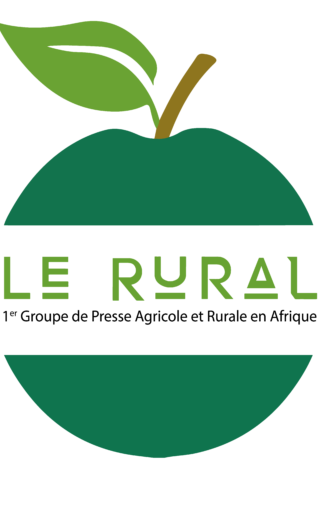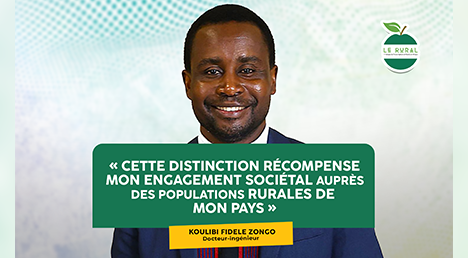Lauréat du prix 2025 de la Fondation FARM, votre journal vous propose cet entretien avec le Docteur-ingénieur Koulibi Fidele Zongo pour avoir une idée claire sur son innovation, ses ambitions et les défis auxquels il fait face.
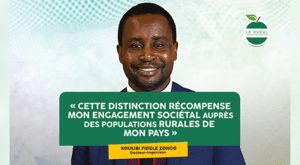
- Dites-nous votre fierté d’être le premier lauréat du prix de la fondation FARM.
Cette distinction de la fondation FARM est une fierté pour moi, car elle récompense mon engagement sociétal auprès des populations rurales de mon pays. La recherche scientifique, selon mon attendement, doit servir à la résolution de problèmes sociaux. Cette récompense met en lumière mes activités de recherche action dans le domaine de la gestion durable de la fertilité et la productivité des sols.
-
Pouvez-vous nous décrire en quoi consiste précisément l’innovation en production de compost qui vous a valu le Prix 2025 de la Fondation FARM ?
L’innovation a consisté en une recherche action participative où le producteur est l’acteur de la recherche. Ainsi, nous avons diagnostiqué avec les producteurs, les déterminants de la productivité des sols dans un contexte sahélien marqué par un défi climatique et un contexte sécuritaire particulier. Le diagnostic a montré que la gestion de l’eau et des nutriments (la matière organique) déterminent la productivité agricole dans la région Nord du Burkina Faso.
En rappel, les sols dans cette région du pays sont fortement encroûtés avec une profondeur très limitée et un taux de matière inferieur à 1% d’où leur faible productivité. Pour répondre à cette faible productivité des sols, nous avons entrepris avec les 42 femmes de l’association NABONSWENDE la caractérisation du compost qu’elles produisent pour donner un support scientifique à leur activité. Ces composts sont spécifiques, car ils sont produits en 45 jours avec des matériaux et un savoir-faire locaux.
En plus de cela, nous avons conduit des tests d’amélioration des paramètres de fertilité de ces composts en ajoutant des broyats des feuilles de Albizia saman (anciennement Samanea saman) une légumineuse. Les résultats ont été très concluants avec une amélioration des teneurs en NPK par rapport au compost déjà produit par les femmes. Des tests agronomiques participatifs ont été conduits en milieu sur les cultures associées sorgho-niébé (cultures les plus produits et consommés dans cette zone du pays) sous du zaï associé à des apports du compost. Les rendements en grains de ces cultures ont été améliorés de plus de 80% pour le niébé et d’environ 90 % pour le sorgho ainsi que la fertilité organique et chimique du sol sous des apports de 3t/ha de compost par rapport au témoin sans aucun apport de compost.
-
Quels sont les principaux bénéfices de cette innovation pour les agriculteurs et l’environnement du Burkina Faso ?
Les bénéfices pour les agriculteurs sont de raviver dans un premier les sols infertiles de la région afin d’améliorer leurs productions agricoles et leurs conditions de vie. Dans un second temps, la production de compost génère des revenus, car une partie est vendue. C’est une activité génératrice de revenue pour une autonomisation financière de ces femmes rurales. Enfin, sur le plan environnemental l’utilisation de ces composts comme fertilisant permet de réduire la pollution environnementale par l’utilisation des intrants chimiques de synthèse industrielle. Aussi, la fertilisation des sols avec ces composts permet une gestion durable des sols pour un système alimentaire durable.
-
En quoi votre procédé de compostage se distingue-t-il des méthodes traditionnelles ?
Ce procédé de compostage permet d’avoir des composts sans adjuvant en utilisant des matériaux locaux. Par exemple, l’utilisation des graminées de brousse comme source de carbone comparativement à l’utilisation de la paille de sorgho et aussi l’ajout de broyats de feuille de légumineuses. Le temps de compostage est également réduit soit de 45 jours contrairement aux méthodes traditionnelles qui peuvent durer en moyenne 2 mois et, voire plus. Aussi, les paramètres de fertilité sont nettement améliorés en comparaison aux méthodes traditionnelles diffusées.
Le compost mûr passe au tamis et est un engrais organique ce qui témoigne de son efficacité sur les performances agronomiques des cultures dès la première année d’apport.
-
Vous travaillez avec les femmes. Quelles difficultés majeures rencontrez-vous ?
L’une des principales difficultés rencontrées est le concassage de la bouse de vache qui se fait manuellement par les femmes à l’aide d’un bâton. Il sera nécessaire d’envisager l’achat d’un broyeur. Le petit matériel utilisé pour le compost n’est pas en quantité suffisante d’où le rallongement du temps de travail. La disponibilité des graminées de brousse et des feuilles des légumineuses pourrait, à l’avenir, devenir une contrainte pour la production de compost.
Pour cela, il sera nécessaire d’envisager leur production en bordure des champs ou sous forme de bandes enherbées pendant la saison humide. Par ailleurs, le manque de moyens financiers ne permet pas d’envisager d’autres tests d’amélioration des paramètres de fertilité organiques et chimiques des composts produits ainsi que leurs performances agronomiques et pédologiques.
-
Comment gérez-vous les défis liés à la sensibilisation des agriculteurs sur l’utilisation du compost ?
Les défis liés à la sensibilisation des agriculteurs sur l’utilisation du compost est d’arriver à leur prouver les bienfaits sur le plan agricole et environnemental de la fabrication et l’utilisation du compost comme fertilisants. Dans ce sens, l’approche recherche action utilisée dans le cadre de cette activité de production de composts est un schéma qui facilite la vulgarisation et la sensibilisation. Le producteur étant acteur de la recherche, cela facilite la diffusion et l’appropriation des résultats de la recherche. Ainsi, de fil en aiguille, l’innovation est facilement acceptée et rentre dans les habitudes culturales.
Par ailleurs, l’élaboration d’une fiche technique de la production de compost aiderait à la sensibilisation des producteurs.
-
Comptez-vous élargir l’utilisation de votre innovation au-delà du Burkina Faso ? Si oui, comment envisagez-vous ce déploiement ?
Je compte élargir cette innovation dans d’autres villages du Burkina Faso et dans le Sahel ouest africain. Cela passe d’abord par une évaluation technico-économique de l’innovation afin de s’assurer de sa rentabilité économique. Ensuite, il faut trouver ou identifier des associations de femme intéressées par l’innovation. La diffusion se fera par des partages de savoir-faire et des échanges d’expérience sur la production de compost par les femmes de l’association NABONSWENDE. Pour ce faire, il sera nécessaire de bénéficier de l’appui matériel et financier de l’Etat, d’une collaboration avec FARM et des ONG intéressés par le projet.
-
Mot de fin
Je remercie une fois de plus la fondation FARM pour ce prix. Cette reconnaissance montre que la fondation se soucie de l’alignement entre recherche scientifique et développement rural.
Je dédis ce prix aux 42 femmes de l’association NABONSWENDE dans la région Nord du Burkina Faso. Il serait souhaitable que cette approche soit dupliquée dans d’autres villages du Burkina Faso afin de contribuer à l’offensive agropastorale et halieutique du Burkina Faso.
Je salue mes collègues du Centre universitaire de Tenkodogo de l’université Thomas SANKARA de Ouagadougou ainsi que les étudiants avec qui nous avons conduit ces activités de recherches. J’ai une pensée spéciale pour Monsieur Réné Billaz dit le baobab qui a su m’accompagner et me soutenir dans plusieurs de mes projets. C’est lui qui m’a encouragé à candidater pour ce prix.
Je remercie CASE Burkina et l’ONG ARFA, pionnier de l’agroécologie au Burkina Faso, qui soutiennent ces femmes. Je remercie également Le Rural. À travers cette interview, vous rendez visibles mes activités de recherche participative au profit du développement rural.
Lire aussi : BÉNIN : Le digital pourrait générer 309 millions $ d’ici à 2028 dans le secteur agricole
Réalisé par Jean-Baptiste HONTONNOU