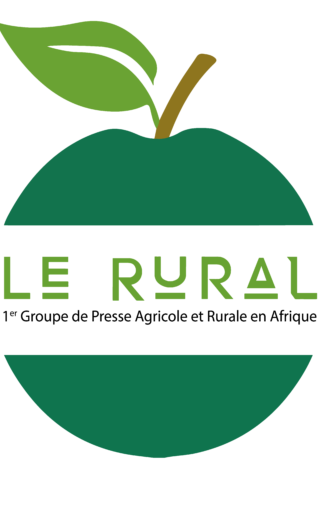L’infécondité animale représente un défi majeur pour les éleveurs, entraînant des pertes économiques significatives. Entre facteurs nutritionnels, génétiques et sanitaires, comprendre les causes de cette problématique est essentiel pour améliorer la productivité du secteur.

Dans les plaines verdoyantes du nord-est du Bénin, l’élevage constitue une source de subsistance pour de nombreuses familles. Cependant, l’infécondité des animaux d’élevage compromet sérieusement la rentabilité de cette activité. Selon une étude menée par la FAO, le taux moyen de fécondité des bovins dans cette région est de 65,4 %, avec un âge au premier vêlage estimé à 3,5 ans et un intervalle entre vêlages de 15 mois.
La sous-alimentation, tant en quantité qu’en qualité, est l’une des principales causes de l’infécondité. Une carence en minéraux essentiels tels que le phosphore, le sodium, l’iode, le manganèse et le zinc peut entraîner des dysfonctionnements reproductifs. De plus, l’avitaminose A, fréquente après une longue saison sèche, inhibe l’activité ovarienne des femelles animales.
Conséquences de la consanguinité
Dans les départements de l’Ouémé et du Plateau, une enquête a révélé que de nombreux éleveurs accouplent des animaux ayant un lien parental, sans schéma de croisement spécifique. Cette pratique favorise la consanguinité, entraînant une mortalité élevée à la naissance, une croissance lente et une diminution de la taille des portées.
Face à ces défis, le gouvernement béninois a mis en place des programmes d’insémination artificielle pour améliorer la diversité génétique et la productivité du cheptel. En 2014, dans le cadre du Projet d’appui aux filières lait et viande (PAFILAV), le Bénin a importé 200 génisses gestantes de la race Girolando pour les intégrer au cheptel national. De plus, des efforts sont déployés pour améliorer la nutrition animale, notamment par l’utilisation de résidus de culture pour compléter l’alimentation durant la saison sèche.
Pour illustrer l’impact de l’infécondité, considérons le cas de Adoulaye, éleveur dans la région de Parakou. Il témoigne : « J’ai constaté que mes vaches mettaient plus de temps à donner naissance, et les veaux étaient souvent faibles. Grâce aux nouvelles pratiques d’alimentation et à l’insémination artificielle, j’ai vu une nette amélioration ».
De même, Charles, éleveur de bœuf, partage son expérience : « La consanguinité était un problème dans mon troupeau. En introduisant de nouveaux reproducteurs et en évitant les accouplements entre parents proches, la santé de mes porcelets s’est améliorée ».
Selon une étude publiée en 2005, l’âge au premier vêlage des vaches de race Lagunaire au Bénin est de 4 ± 0,5 ans, avec un intervalle entre vêlages de 14 ± 2,8 mois. Ces indicateurs reflètent une faible performance reproductive, impactant directement la rentabilité des élevages.
Détecter précocement l’infertilité chez les jeunes vaches est essentiel pour assurer la rentabilité de l’élevage. Les éleveurs doivent être attentifs à plusieurs signes dès le jeune âge de l’animal. Par exemple, des chaleurs irrégulières, qu’elles soient trop courtes (moins de 16 jours) ou trop longues (plus de 24 jours), peuvent indiquer des troubles fonctionnels de la reproduction. De plus, l’absence de manifestations de chaleurs ou des chaleurs silencieuses peut signaler des anomalies ovariennes, telles que des kystes.
Les kystes ovariens se manifestent souvent par une absence de chaleurs ou, au contraire, par une nymphomanie. Les éleveurs doivent également surveiller les signes extérieurs, tels que l’œdème de la vulve, la présence de glaires claires indiquant des chaleurs normales, ou des écoulements purulents suggérant une infection utérine. Une observation attentive et régulière du comportement reproducteur et des signes physiques permet d’identifier rapidement les vaches potentiellement infertiles et de consulter un vétérinaire pour un diagnostic précis.
L’infécondité animale constitue une menace réelle pour la durabilité de l’élevage au Bénin. Toutefois, avec des initiatives ciblées en matière de nutrition, de gestion génétique et de santé animale, il est possible d’inverser la tendance et d’assurer un avenir prospère aux éleveurs béninois.
Lire aussi : BÉNIN : L’usine sucrière SUCOBE à Savè rouvre bientôt ses portes
Innocent AGBOESSI